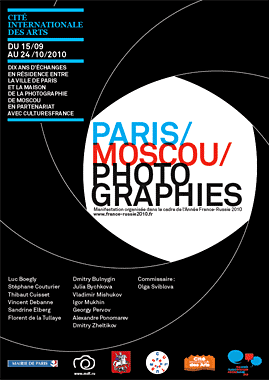Monet, ce n’est qu’un oeil,
mais quel oeil !
Paul Cézanne
J’ai quelquefois du mal à aborder des expositions magistrales comme celle que le Grand Palais consacre cet automne à Claude Monet. On a l’impression qu’on connaît déjà par cœur, qu’on ne pourra plus avoir aucun plaisir de découverte : soixante ans de peinture, pilier de l’impressionnisme, fournisseur intarissable de produits dérivés pour les boutiques de musée, les calendriers et les cartes postales. Et puis ça ne se passe pas comme ça…
Alors bien sûr, les conditions ne sont pas idéales, l’affluence est énorme, même à des horaires inhabituels (pour moi le créneau de 21 h). Dans le cas de Monet, le nombre de personnes qui se pressent devant les tableaux est d’autant plus problématique que ceux-ci demandent à être regardés à une certaine distance. Par contre, il est formidable de voir « en vrai » certaines œuvres qu’on ne connaissait que par reproductions, tant les nuances sont subtiles et les lumières étonnantes. Je pense par exemple aux paysages de neige comme La Pie.
On y voit donc aussi les grandes « séries » de peintures sur un sujet unique que Monet a réalisées, les meules, les bords de Seine, la cathédrale de Rouen. En fait ce qui m’a frappée surtout, sans doute parce que l’exposition Turner du printemps dernier est encore relativement fraîche dans ma mémoire, c’est la parenté entre certaines œuvres de Monet et celles de Turner dans la manière de traiter la lumière. Ainsi l’exposition actuelle contribue à confirmer la place de Turner comme précurseur de l’impressionnisme. Monet était allé en Angleterre pour la première fois en 1870. Il avait eu l’occasion d’y admirer les œuvres de Turner, notamment des scènes de brouillard sur la Tamise à Londres. Il avait aussi rencontré, à cette occasion, le peintre américain Whistler, également influencé par Turner, avec lequel il s’était lié d’amitié.
Ce que Monet avait vu à Londres l’incita à y revenir plusieurs fois. Lors de séjours de 1899 à 1901, prolongés par son travail en atelier jusqu’en 1904, il peignit une autre série, de près d’une centaine de tableaux, sur le thème du brouillard londonien. Le Grand Palais avait d’ailleurs monté en 2004 une exposition « Turner/Whistler/Monet » afin de montrer les relations et l’évolution entre les premiers tableaux de Monet inspirés par la Tamise, en 1871, et les « séries » qu’il peignit à Londres en 1899-1901 (avec les motifs du pont de Charing Cross, du Parlement et du pont de Waterloo) à la lumière de nombreuses peintures, aquarelles et gravures de Turner et de Whistler. Une même confrontation mettait en présence des œuvres réalisées par les trois maîtres à Venise, où Monet se rendit en 1908 : les vues que ce dernier peignit alors des palais du Grand Canal et de l’île San Giorgio Maggiore évoquent directement celles de Londres exécutées quelques années auparavant…